« Nous avons parlé européen. C’est une langue nouvelle qu’il faudra bien que l’on apprenne. »
Aristide Briand, président du conseil et ministre des affaires étrangères à la Chambre des députés, lors de la 2e séance du 26 février 1926
Discours publié à L’Harmattan dans « Parlement[s], Revue d’histoire politique », 2004/1 n° 1 | pages 113 à 122, ISSN 1768-6520
M. Aristide Briand, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères :
[…]
Messieurs, pour assurer la paix, c’est l’Europe qu’il s’agit d’organiser.
Si vous ne voulez pas que l’incendie éclate de nouveau, il faut sans doute que vous preniez les précautions nécessaires à la paix.
Gardons notre force. Certes, s’il y avait dans le traité de Locarno quoi que ce fût qui diminuât en rien notre possibilité de nous défendre, même seuls, contre la moindre menace, alors je vous dirais : « Ne ratifiez pas ! Votre devoir de représentants est de refuser votre signature au traité qu’on vous présente. » (Très bien ! très bien ! à gauche.)
Mais il n’y a rien, absolument rien de tel. Le traité de Locarno ne nous enlève aucune possibilité de défense.
Si, par des pactes nouveaux qui ne manqueront pas de naître du même esprit – l’esprit de la Société des nations – les garanties vont s’élargissant, si les tendances des peuples deviennent meilleures, si même en Allemagne, malgré des conseils pernicieux donnés dans ce pays, le peuple en vient à se tourner vers son intérêt réel, et réfléchissant au danger de certaines excitations, s’ouvre sincèrement à des idées de paix – cela ne pourra pas résulter d’un document noir sur blanc, […] mais bien d’une propagande vivante, incessante, et croissant de jour en jour (Applaudissements) – si un pareil effort est fait dans tous les pays, sans distinction de partis, je suis convaincu qu’il deviendra possible de réaliser la sécurité dans la paix définitive. (Applaudissements à gauche, à l’extrême gauche et au centre.)
Pour le moment, nous n’en sommes encore qu’à un commencement, vous m’entendez bien. Et ce commencement, ce petit germe, il ne faut pas le détruire : il faut le laisser vivre. […]
Croyez-vous […] que je sois allé sans émotion à ce rendez-vous, au bord d’un lac1, où je devais rencontrer des ministres allemands ? Croyez-vous que je n’éprouvais pas les sentiments les plus complexes et les plus profonds ?
J’y suis allé, ils sont venus, et nous avons parlé européen. C’est une langue nouvelle qu’il faudra bien que l’on apprenne. (Vifs applaudissements à gauche, à l’extrême gauche et sur divers bancs au centre.) […]
Le peuple allemand est un grand peuple, il a ses qualités et ses défauts.
Le peuple français et lui se sont rencontrés, à travers les siècles, sur bien des champs de bataille qu’ils ont ensanglantés. La dernière guerre a été effroyable, elle a dépassé toutes les prévisions. Ce ne sont plus des armées
restreintes qui ont été aux prises, ce sont des nations entières qui, pendant des années, se sont déchirées.
Et puis, il y a eu les vainqueurs, oui ! qui sont sortis de là avec un grand prestige, avec une force morale agrandie, certes. Mais aussi dans quel épuisement !
Où sont les peuples qui peuvent résister à telles secousses ? Et quelles craintes n’éprouve-t-on pas quand on les voit dans cet état de faiblesse psychologique, de faiblesse financière, et qu’on se dit que, demain peut-être, faute
de quelques précautions, faute d’accords qui les obligent à réfléchir le temps nécessaire pour se détourner de la guerre, ils pourraient être rejetés encore les uns contre les autres dans de pareilles convulsions ! Mais que
resterait-il donc de ses malheureux peuples si une nouvelle guerre survenait ? (Vifs applaudissements à gauche, à l’extrême gauche et au centre.). Je vous le dis simplement, faisant appel à votre raison, à vos coeurs et à votre
patriotisme : Locarno, c’est ce qui peut empêcher tout cela. Locarno est une barrière contre l’irréflexion. Locarno, c’est la nécessité de discuter. C’est, pour les peuples, la possibilité de se donner une raison de ne pas tomber
aveuglément les uns sur les autres.
Ne serait-ce que cela, messieurs, ce serait énorme.
[…]
Les deux nations vont-elles se battre, ainsi, à travers les siècles, éternellement ? Vont-elles toujours se couvrir de deuils et de ruines ? Elles auront créé, sous l’influence des progrès économiques, de magnifiques usines, elles auront
organisé des centres de production admirables et, tous les vingt-cinq ans, tous les cinquante ans, le rouleau des armées viendra tout anéantir, les incendies s’allumeront de toutes parts, le sang sera répandu à flot ? Non !
(Vifs applaudissements prolongés à gauche, à l’extrême gauche, au centre et sur divers bancs à droite.)
Dans cette trop longue intervention, j’ai seulement voulu dégager l’esprit de Locarno : c’est sous l’influence de cet esprit que j’ai signé.
Avoir eu de telles pensées, je n’estime pas que ce soit indigne d’un bon Français. Je ne considère pas que j’aie démérité de mon pays, ni que mon patriotisme ait été amoindri, par le fait que j’ai eu confiance dans la paix, confiance dans la force morale de la France, pour l’organisation de la paix avec le concours des autres peuples, parce que je crois que nous sommes à l’aurore d’un temps nouveau.
L’Europe ne peut pas rester divisée comme elle l’est, ni dans ses intérêts politiques, ni dans ses intérêts économiques. (Applaudissements à gauche, à l’extrême gauche et au centre.)
Il y a des questions qui obligent les hommes à se connaître, par des contacts, par des conversations. Se connaît-on quand on se contente de discuter diplomatiquement, à travers l’espace ? La vie est-elle seulement dans un
papier, si bien rédigé soit-il ? N’est-elle pas dans l’homme, dans son regard, dans tout ce qui émane de lui ? […]
Oh ! il y aura des difficultés. Le soulier de Locarno ne sera pas sans faire souffrir, à certaines heures, le marcheur. Il faudra s’en accommoder. Il s’accommodera lui-même peu à peu.
Mais moi j’aurais été au-dessous de ma tâche, ayant l’honneur de représenter le Gouvernement, si j’avais eu assez peu de confiance en mon pays pour croire qu’il s’amoindrirait dans sa force morale et matérielle en prenant part à des discussions qui préparent l’Europe de demain.
Alors que les peuples s’organisent pour des temps nouveaux, comment la France qui, toujours, même aux heures les plus difficiles, les plus troubles, a été à l’avant-garde, montrant la route, se tiendrait-elle dans son coin, enveloppée
dans sa victoire, l’oeil méfiant et la mine hargneuse ?
Allons donc ! Imaginer cette France-là ? Jamais ! (Vifs applaudissements à gauche, à l’extrême gauche et au centre.)
En participant à tous les accords qui sont susceptibles d’améliorer, non pas sa condition, mais la condition des peuples, la France se montre ce qu’elle est : la France d’hier, d’aujourd’hui et de demain. (Vifs applaudissements prolongés sur un grand nombre de bancs. – MM. Les députés siégeant à gauche, à l’extrême gauche et au centre se lèvent et applaudissent longuement. – M. le président du Conseil, de retour à son banc, reçoit des félicitations.)
Annales de la Chambre des Députés, Débats parlementaires, 2e séance du 26
février 1926, p. 900-904.



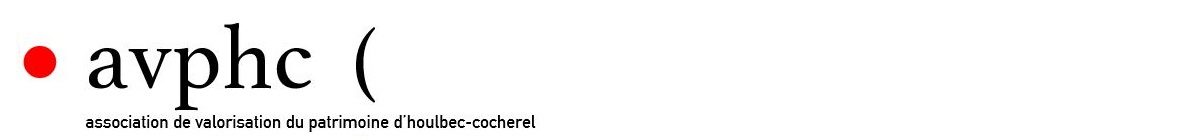
1. 2. 3. Nadine marlard 4. Helene moulin 5. Yvette Tanguy 6 7 8. 9. 10 Danielle gouget 11. Jocelyne…